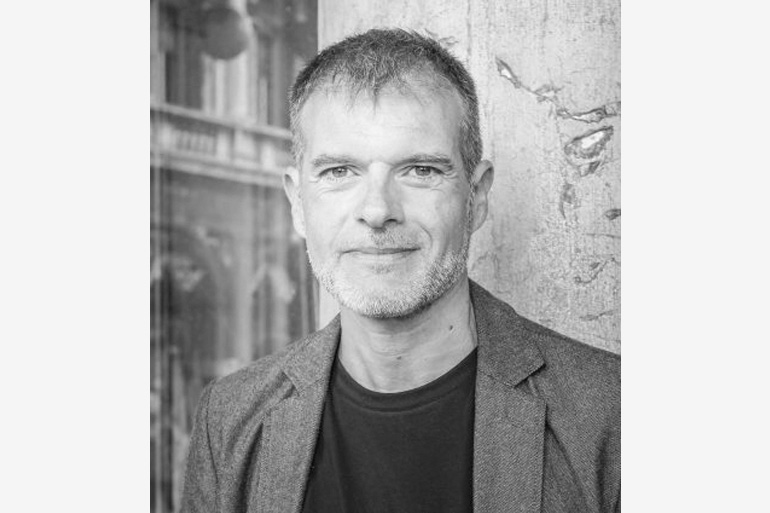Ce texte a existé sous forme de pièce de théâtre (Chapitres de la chute). Pourquoi et comment l’avez-vous « augmenté », comment avez-vous travaillé votre style, et quel effet souhaitez-vous obtenir sur le lecteur solitaire et silencieux de ces 848 pages ?
En réalité, le roman a existé avant le texte pour le théâtre, la version longue avant la courte. C’est à la demande d’Arnaud Meunier – qui dirige la Comédie de Saint-Étienne et qui a monté le spectacle avec succès –, que j’avais tiré du roman une version destinée à la scène et qui était encore trop longue ! Je voulais d’emblée écrire une histoire très ample et un livre long, mais cette version n’a paru en Italie que dans un second temps. C’est donc le projet Lehman complet qui a vu alors le jour.
Vous avez lu quantité de livres sur la finance et l’économie, mais aussi exploré des monceaux d’archives sur les frères Lehman et leur dynastie. Quelle est la part de
« vrai », d’attesté, dans la vie de la famille ? Et quelle est la part d’invention romanesque et poétique de votre cru ? Tous les détails que vous apportez sont criants de vérité. On a envie de savoir, par exemple, si le gâteau à l’anis arrosé de liqueur servait vraiment d’appât pour les contrats juteux ? Ou si Dreidel a vraiment foutu le feu à la fontaine de pétrole ?
On trouve de très nombreux ouvrages en anglais sur les Lehman, la famille, la banque. Je les ai tous lus, intégralement, pour connaître les faits et les personnages. Par conséquent, dans le roman, tout est conforme à la réalité : les données factuelles mais aussi les caractéristiques des individus et les événements. Après avoir tout consigné, j’ai contextualisé, mis en situation et recouru à des procédés littéraires, en particulier les rêves et les cauchemars, pour bâtir le roman.
Aujourd’hui même (l’entretien a eu lieu le 23 mai 2018), nous venons d’apprendre la disparition de Philip Roth et, d’une certaine façon, l’histoire des Lehman est une histoire qui aurait pu l’inspirer. Il est, pour moi et pour mon travail d’écrivain, un auteur fondamental car il a beaucoup œuvré à gommer les frontières entre vision et réalité, entre roman et documentaire. Lui aussi, plus que tout autre, a raconté l’histoire américaine d’un point de vue littéraire et éthique, comme le souligne le titre d’un de ses plus grands romans, Pastorale américaine.
Les mots répétés, scandés, défilent sous nos yeux fascinés comme sont répétées les lignes de chiffres sur les écrans de la Bourse. Mais les mots, même s’ils sont comptés, comptabilisés, utilisés, les mots ne sont pas des chiffres, ils font réfléchir. Peuvent-ils être des antidotes au poison du calcul devenu fou ?
Cette question m’évoque Les Temps difficiles de Charles Dickens. Dans une scène de la première partie, un instituteur demande à ses élèves de définir ce qu’est un cheval. L’une d’eux, qui est pourtant la fille d’un dompteur de chevaux de cirque, ne sait pas quoi lui répondre, et c’est un de ses camarades qui le fait à sa place : « Un quadrupède de la famille des équidés, avec tant de dents, etc. » À cette époque déjà, Dickens critique une société qui s’oriente vers les chiffres et les définitions, et dans laquelle ce qui compte n’est pas de savoir quoi faire d’un cheval, mais de pouvoir en donner une définition chiffrée. On ne connaît plus la réalité qu’à travers les nombres, un phénomène dont nous sommes aujourd’hui tous victimes : l’obsession des chiffres, le rôle des algorithmes. C’est ce qu’incarne le personnage d’Arthur Lehman dans le livre : quelqu’un qui, encore enfant, est déjà obnubilé par l’idée de traduire le monde en chiffres.
« On n’a pas le choix » est une phrase qu’un être humain entend plusieurs fois quotidiennement, de nos jours. Comme si le citoyen lambda avait intégré l’injonction thatchérienne au nom de cyclone, TINA (There Is No Alternative). Or vous démontrez dans votre récit que, à chaque instant, à chaque occasion, quelqu’un a le choix et choisit. Cette phrase, « On n’a pas le choix », est-elle le plus grand mensonge contemporain ?
Absolument. Prétendre qu’il n’y a pas d’alternative est un authentique mensonge. Le problème, comme l’a montré la psychanalyse, c’est qu’il est plus facile de ne pas avoir le choix. Nous voulons être libres, mais nous avons peur de la liberté. Choisir, décider, est une obligation autant qu’une liberté. L’histoire des Lehman est une histoire de choix. Henry, le fondateur, choisit de quitter la Bavière pour aller aux États-Unis et travailler dans l’industrie textile. Puis il choisit de cultiver le coton, avec tout ce que cela implique (plantations, esclaves), et, enfin, il choisit de rester une fois sa fortune faite. À chaque étape, les Lehman choisissent. C’est ce que fait l’économie : choisir de fabriquer des voitures, de produire des ordinateurs, de vendre de nouveaux téléphones portables, avant que nous n’en manifestions le besoin, avant que nous les choisissions, nous. Ce roman est l’histoire des choix qu’opèrent et imposent les frères Lehman et leurs descendants.
L’argent ne fait pas le bonheur, a dit Freud, parce que ce n’est pas un rêve d’enfant. Ni banquier ni financier ne sont des vocations d’enfant. Et, pour vous, l’écriture est-elle une vocation ? Dans quelles circonstances en avez-vous pris conscience ?
Je viens du théâtre. C’est lui qui m’a conduit à l’écriture. Le théâtre comme partage, communication directe et générosité narrative. Puis j’ai découvert qu’il existait d’autres formes de partage et, comme l’histoire des Lehman me passionnait, l’écriture romanesque a été ma façon de la partager avec autrui. Si, aujourd’hui encore, nous pouvons avoir des discussions sur Hamlet ou le capitaine Achab – c’est-à-dire des personnages de fiction, pas des personnes qui ont existé –, c’est parce que quelqu’un a écrit leur vie, et c’est ce que j’ai voulu faire avec les Lehman, toutes proportions gardées.
Votre texte est parsemé de références, rythmé par des citations de la Bible ou du Talmud. Quelle place peuvent tenir, selon vous, les Écritures dans nos vies athées, agnostiques ou simplement révoltées par les carcans des religions ?
Comme l’a dit le grand metteur en scène Luca Ronconi, le parcours de la famille Lehman exprime un changement de religion. Après une série de rites, après un Livre, ils se convertissent à d’autres rites, la Bourse, la finance, et à un autre livre, le Wall Street Journal. Même quand nous sommes apparemment athées ou agnostiques, nous sommes soumis, nous aussi, à cette nouvelle forme de religiosité concrète, matérielle : la consommation, la communication. C’est une religion sans livre, où les chiffres comptent plus que les mots, et où tout rassemblement, toute congrégation est abolie au profit du règne de l’individu dans sa solitude. Les lieux de rassemblement comme les églises, mais aussi les stades de football ou les salles de concert, disparaissent, et c’est là un danger qui nous menace tous.
Propos recueillis par Sophie Chérer et Vincent Raynaud.
Photo : © D.R.